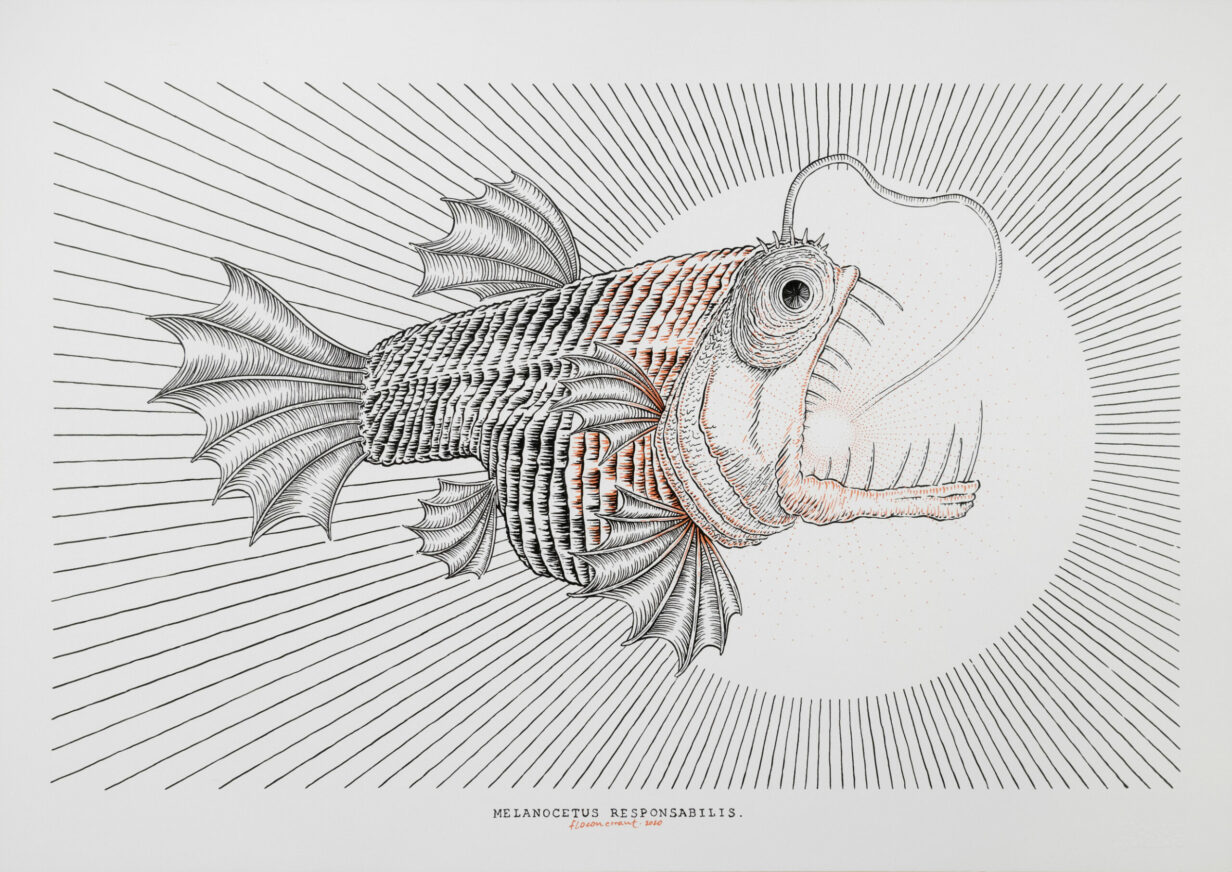Les grandes entreprises jouent avec votre vie
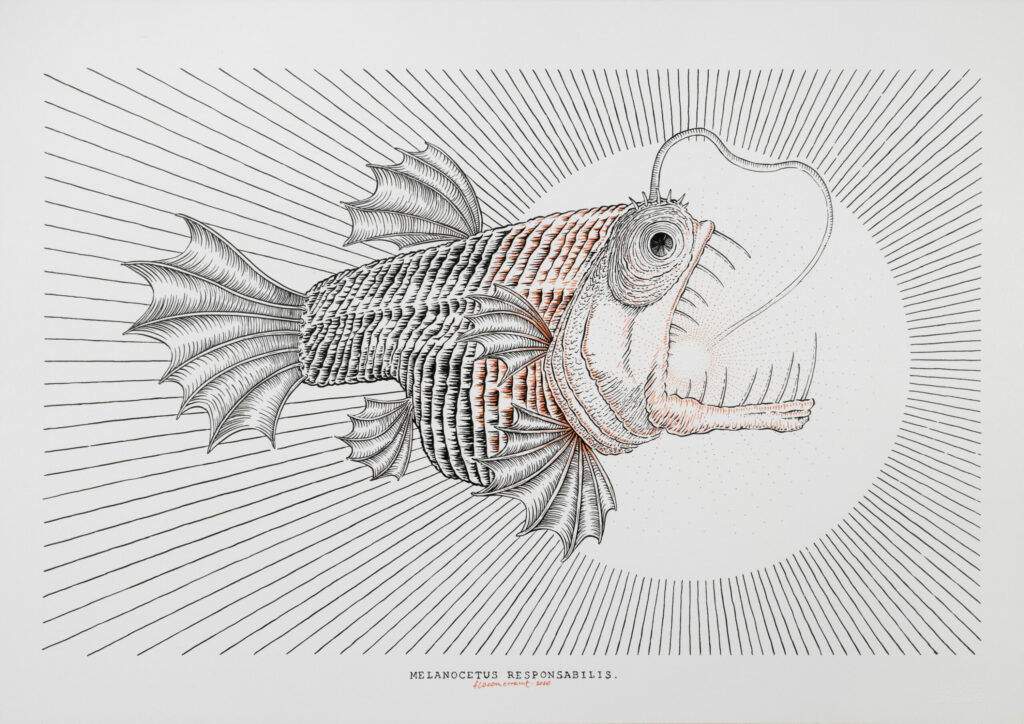
Le 10 mars 2019, un Boeing 737 MAX d’Ethiopian Airlines s’est écrasé au décollage, creusant un énorme cratère. Les 157 personnes à bord ont péri, dont de nombreux employés des Nations Unies et d’organisations d’aide humanitaire. Cinq mois auparavant, en octobre, un avion du même type appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air s’était abîmé en mer dans des circonstances étrangement similaires, faisant 189 victimes. Ces deux tragédies ont choqué l’industrie des voyages dans le monde entier. Tous les Boeing 737 MAX ont été cloués au sol. Selon l’enregistreur vocal de la boîte noire, le copilote du vol Lion Air a cherché jusqu’au bout à redresser l’appareil. A la fin, il priait.
Ces accidents ont quelque chose de familier : ce n’est pas la première fois que des entreprises choisissent en toute connaissance de cause d’exposer leurs clients et employés à de graves dangers. L’entreprise elle-même n’assume qu’une faible part de ce risque. En fait, ce n’est que dans la mesure où sa responsabilité pénale pourrait être engagée qu’elle prend en compte les dangers qu’elle fait courir à des tiers, par exemple aux passagers et aux équipages des avions qu’elle a construits. Hors de ce cas de figure, le risque est vu comme une « externalité », un effet collatéral qu’elle peut se permettre d’ignorer, à l’instar, si souvent, de la pollution environnementale.
« Visiblement, Boeing a pesé de tout son poids sur l’agence fédérale américaine. Cette trop grande proximité entre les grands groupes industriels et les instances gouvernementales est un problème récurrent. La complaisance des autorités face au géant Boeing a clairement contribué aux pertes humaines. »
L’enquête à propos du crash d’Ethiopian Airlines n’en est qu’à ses débuts. Mais des similitudes entre les deux catastrophes permettent déjà de mettre en cause le logiciel du nouveau système antidécrochage MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) pour lequel de nombreux pilotes n’étaient pas formés. Conçu tout spécialement pour le Boeing 737 MAX, il empêche l’avion d’adopter une pente ascendante trop forte. Apparemment, il s’est basé sur des données fournies par un seul capteur, qui a dysfonctionné : il a envoyé au logiciel des informations erronées disant que l’avion grimpait trop vite. Le MCAS a alors pris la main et automatiquement mis l’avion en piqué à plusieurs reprises, alors que les pilotes tentaient de reprendre le contrôle. D’où les décollages erratiques et finalement le crash des deux appareils. Mais la FAA, l’agence fédérale de l’aviation civile, a également été épinglée : elle a donné son feu vert de manière précipitée au nouveau MCAS. Elle n’a pas jugé bon, d’entente avec Boeing, de prévoir une formation spécifique. De plus, elle a traîné les pieds pour interdire de vol les Boeing 737 MAX après le deuxième crash. Visiblement, Boeing a pesé de tout son poids sur l’agence fédérale américaine. Cette trop grande proximité entre les grands groupes industriels et les instances gouvernementales est un problème récurrent. La complaisance des autorités face au géant Boeing a clairement contribué aux pertes humaines.
Fait aggravant : deux dispositifs de sécurité pourtant essentiels manquaient à l’appel. Ils auraient permis de détecter les erreurs de mesure qui sont vraisemblablement à l’origine des crashs. L’un est un indicateur numérique d’angle d’attaque qui affiche les mesures prises par deux capteurs. L’autre est une alarme lumineuse qui signale aux pilotes un conflit d’interprétation entre ces deux capteurs.
« Ces crashs discréditent le vieux mythe sur l’efficacité de l’économie de marché : la dynamique concurrentielle tant vantée n’améliore ni la qualité, ni la sécurité des produits. »
Ces dispositifs auraient pu sauver des vies. Mais Boeing en avait fait des options payantes, comme s’il s’agissait d’équipements de confort ou de luxe. Certaines compagnies aériennes, American Airlines par exemple, ont acheté ces équipements de sécurité en option, y compris des extincteurs supplémentaires. Southwest Airlines a opté pour l’alarme lumineuse avant d’acquérir plus tard l’indicateur numérique d’angle d’attaque. En revanche, United Airlines a fait l’impasse sur les deux. Malheureusement, rares sont les compagnies aériennes de pays en voie de développement qui peuvent se permettre d’acheter ces options payantes, même si leur installation n’est pas ruineuse. Après les accidents, Boeing a soudain annoncé que l’alarme lumineuse signalant des mesures contradictoires serait désormais montée d’office. Une manœuvre assez grossière pour calmer les esprits.
Ces crashs discréditent le vieux mythe sur l’efficacité de l’économie de marché : la dynamique concurrentielle tant vantée n’améliore ni la qualité, ni la sécurité des produits. En réalité, les passagers et les équipages victimes de ces accidents font partie de la longue liste des personnes dont la vie ne comptait tout simplement pas aux yeux des entreprises.
Explosions à gogo
Autre exemple : en 1997, une famille américaine a intenté un procès à General Motors (GM), l’accusant d’avoir mis sur le marché un produit défectueux. Sa voiture avait pris feu après une collision arrière mineure et les occupants avaient été sévèrement brûlés. Lors du procès, il a fallu menacer GM d’outrage au tribunal pour que l’entreprise divulgue un mémo interne datant de 1973, intitulé « Value Analysis of Auto Fuel Fed Fire Related Fatalities », plus connu sous le nom de mémo Ivey. Rédigé par un ingénieur de General Motors, Edward Ivey, à la demande de la direction, il évaluait froidement les coûts potentiels pour GM des décès liés à l’explosion des réservoirs de carburant.
« Mais renforcer les modèles vulnérables aurait coûté très cher. Edward Ivey a alors été chargé de faire une analyse coûts/bénéfices. L’entreprise voulait savoir s’il était plus coûteux d’indemniser les victimes ou de modifier la chaîne de montage des modèles en question. »
Ce document très court (disponible en ligne en anglais) avait été établi parce que certains modèles de General Motors, à cette époque déjà, avaient une fâcheuse tendance à prendre feu d’un coup à la suite d’une collision arrière même légère : leur réservoir était placé tout près du parechoc arrière, sans plaque de protection. Au moindre impact, le réservoir se fissurait, du carburant s’échappait et la voiture s’embrasait d’un coup. Mais renforcer les modèles vulnérables aurait coûté très cher. Edward Ivey a alors été chargé de faire une analyse coûts/bénéfices. L’entreprise voulait savoir s’il était plus coûteux d’indemniser les victimes ou de modifier la chaîne de montage des modèles en question.
Le calcul était simple, mais brutal. Sachant que l’on comptait chaque année quelque 500 accidents mortels liés à l’explosion du réservoir de carburant et que les dommages et intérêts à verser pour chaque cas se montaient en moyenne à 200’000 dollars et sachant aussi que 41 millions de voitures construites par GM circulaient alors sur les routes, Edward Ivey a calculé que ces accidents mortels allaient coûter à GM 2,40 dollars par voiture produite. Il a ensuite évalué que la pose préventive d’un renfort à l’arrière ne devrait pas dépasser 2,20 dollars par voiture neuve. On était loin des coûts effectifs, bien plus élevés. Indemniser était donc l’option la moins chère.
Le mémo a été la pièce maîtresse du procès de 1997. Les avocats de GM ont commencé par nier son existence. Puis ils ont nié que la direction en avait connaissance. Puis ils ont tenté d’imposer l’idée que le document n’était pas pertinent dans le cadre du procès. La phrase la plus révélatrice du mémo figure dans le premier calcul : « Chaque décès vaut 200’000 dollars. » Elle illustre à quel point le marché dysfonctionne quand il s’agit de gérer des externalités.
« Les décès liés à des accidents dus à l’embrasement du réservoir coûtent à GM 2,40 dollars par voiture, dans le contexte actuel. »
L’objectif n’est pas de faire un mauvais procès aux employés de GM, ni de les accuser de cynisme, ni d’affirmer que la firme ne se souciait pas des vies humaines. De fait, dans sa conclusion, le mémo dit bien : « Il est impossible de chiffrer la valeur d’une vie humaine. » Mais le fait est que la firme n’a été affectée que par les indemnités de 200 000 dollars, la somme moyenne fixée par les tribunaux de l’époque. C’est ce seul chiffre qu’elle a pris en compte.
Et s’il est « impossible » de chiffrer la valeur d’une vie, General Motors a bel et bien mis un prix sur ces vies fauchées. Le mémo est limpide : « Les décès liés à des accidents dus à l’embrasement du réservoir coûtent à GM 2,40 dollars par voiture, dans le contexte actuel. »
Même si ces accidents mortels engendrent toujours des coûts sociaux élevés, GM n’a pris en compte dans son évaluation de 1976 que les coûts directs liés au règlement des indemnités. La firme était prête à verser 200 000 dollars par décès, avant de passer à autre chose. Quant aux familles concernées, il ne leur restait plus qu’à faire le deuil de leurs proches et à apprendre à vivre avec des personnes à jamais défigurées et mutilées.
A l’instar de General Motors, Boeing a elle aussi fait passer les profits avant les précautions. Installer d’office les deux dispositifs de sécurité sur le 737 MAX aurait clairement réduit les risques pour les passagers et les équipages du vol 302 d’Ethiopian Airlines. Mais Boeing a préféré développer le lucratif marché des équipements de sécurité en option.
Krach boursier et marée noire
Cette même dynamique a contribué à la crise financière de 2008, ou « crise des subprimes ». Comme l’a expliqué le Financial Times, un quotidien conservateur, « le système bancaire a un gros problème : le coût social d’un désastre systémique est bien plus élevé que les pertes que chaque banque doit assumer. En fin de compte, ce sont les régulateurs – et non les investisseurs – qui sont amenés à prendre en charge cette externalité. » Toute institution bancaire est consciente que certains actifs financiers présentent des risques pour l’établissement. Mais elle ne peut pas se permettre de réfléchir au risque « externe » qui peut surgir si le système financier s’effondre à cause des actifs trop risqués qu’elle détient. Autrement dit, la stabilité du système financier n’est pas de son ressort. Quand bien même les investisseurs institutionnels veulent éviter que le système ne s’effondre, leurs obligations fiduciaires en qualité d’investisseurs leur interdisent d’adopter un point de vue systémique plus large. Résultat : le risque est chroniquement sous-évalué sur les marchés financiers. De plus, comme l’explique par ailleurs le Times, la crise financière a été aggravée, à chaque étape de son déroulement, par « cette incapacité à gérer les externalités ». C’est ainsi que les hedge funds ont contribué en vendant leurs stocks à affaiblir encore plus les banques et les assureurs.
« Or les coûts pour dégradations des écosystèmes régionaux ne sont pas à la charge des entreprises. Ils sont considérés comme des externalités, des effets collatéraux qui ne donnent pas lieu à une contrepartie monétaire. »
Mais l’exemple le plus parlant est sans doute la catastrophe qui a eu lieu en 2010 dans le golfe du Mexique, quand la plateforme pétrolière Deepwater Horizon affrétée par British Petroleum (BP) a explosé. Outre les pertes humaines et les blessés, près de 5 millions de barils de brut ont jailli de la tête du puits à 1500 mètres sous le niveau de la mer et se sont déversés au fil des mois dans le golfe du Mexique. Selon la presse spécialisée, à l’instar d’autres géants industriels, BP avait pris de nombreux raccourcis par soucis d’économie, sans se préoccuper le moins du monde des conséquences humaines et environnementales. Et le groupe pétrolier avait aussi totalement sous-estimé les répercussions potentielles de ses activités. Il n’avait donc pas provisionné les risques qui ne l’affectaient pas directement, comme un déversement majeur de pétrole sur des écosystèmes marins et côtiers déjà fragiles. Or les coûts pour dégradations des écosystèmes régionaux ne sont pas à la charge des entreprises. Ils sont considérés comme des externalités, des effets collatéraux qui ne donnent pas lieu à une contrepartie monétaire.
Le groupe BP a ainsi négligé plusieurs alertes. Il a reconnu avoir ignoré le test de pression négative réalisé quelques heures avant l’explosion. Ce test indiquait pourtant « une importante anomalie » qui aurait dû alerter les équipes sur l’instabilité du puits. Un peu plus tard, la brusque éruption de gaz naturel dans la conduite de forage a précipité la catastrophe. De plus, BP n’a pas testé la qualité du ciment, une étape cruciale pour s’assurer de l’étanchéité du joint. Enfin, une seule conduite a été utilisée au lieu de deux, comme le veut la pratique ordinaire : encastrées l’une dans l’autre, elles auraient offert une meilleure sécurité. Un ingénieur BP a d’ailleurs expliqué sans détour que ce choix était motivé par des raisons économiques.
Bref, comme on pouvait s’y attendre à l’ère du libre marché, les risques ont été sous-évalués et les conséquences en aval purement et simplement évacuées. Ces premières conclusions ont été corroborées par la Garde côtière des Etats-Unis et par les régulateurs fédéraux qui ont précisé, dans leur rapport, que l’explosion de la plateforme de forage était principalement due à « une mauvaise gestion des risques ».
Des avions qui volent sans équipements de sécurité considérés comme des options payantes… Un constructeur automobile qui intègre sans coup férir la mort de tierces personnes si les coûts restent supportables pour lui… Un groupe pétrolier qui zappe des procédures de sécurité essentielles en matière de forage en eaux très profondes… Le capitalisme est peut-être le système économique le plus efficace qui soit, mais seulement si on accepte de fermer les deux yeux sur la mise en danger de la vie d’autrui et de l’environnement.
Il ne faut pas en conclure que la vie des pilotes, des conducteurs automobiles ou des écosystèmes du golfe du Mexique ne vaut pas pipette. Le vrai problème, c’est qu’ils ne font pas partie de l’équation. Littéralement.
A propos de l’auteur
Rob Larson est professeur en sciences économiques au Tacoma Community College, Etat de Washington. Il est l’auteur de Bit Tyrants: The Political Economy of Silicon Valley, édité chez Haymarket Books.