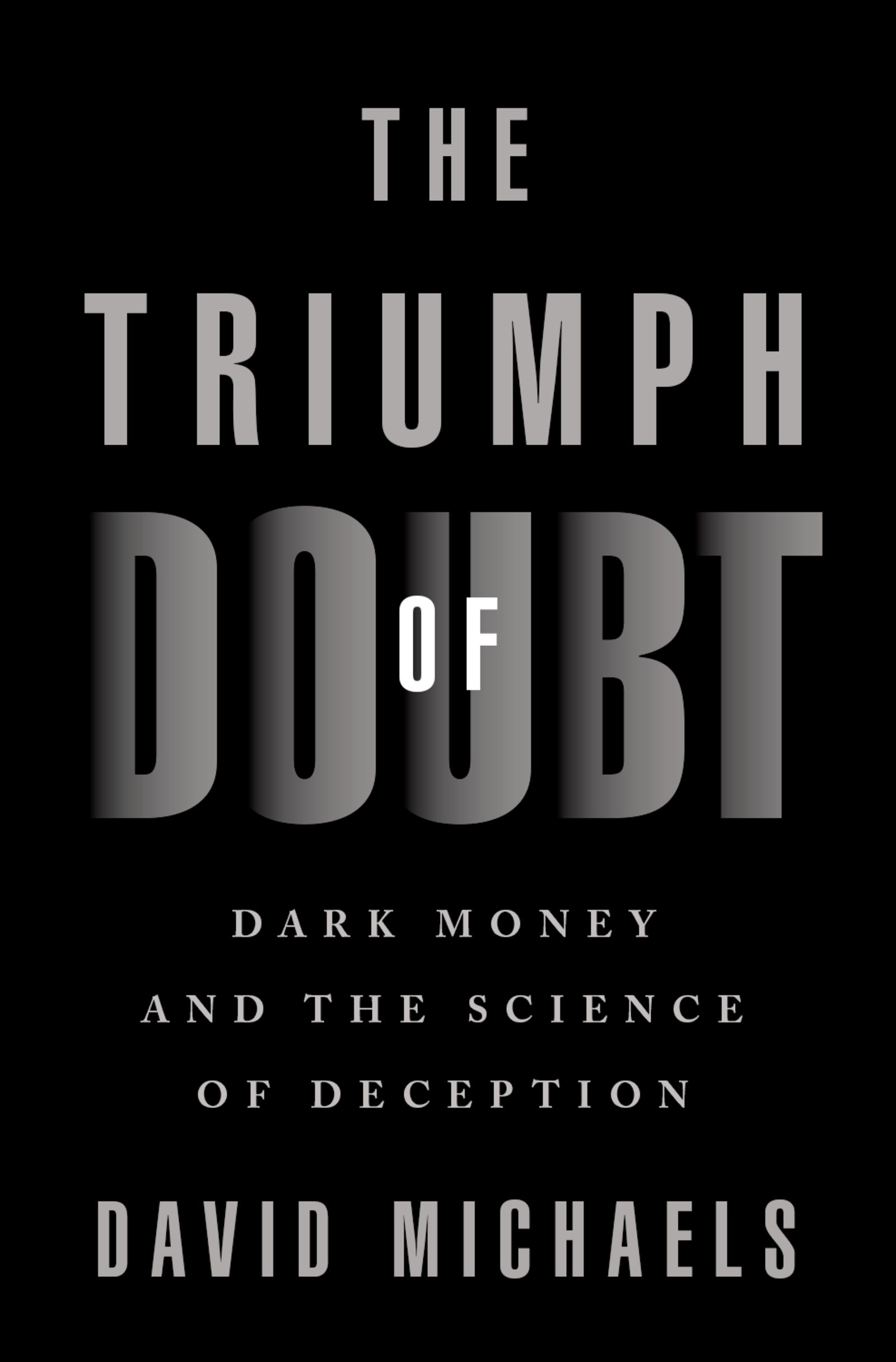La science sous influence

Quand un produit potentiellement dangereux inquiète le public, rares sont les managers qui déclarent : « Nous allons engager les meilleurs scientifiques pour faire une enquête ; s’il y a un problème, nous stopperons la fabrication de ce produit. »
De fait, ils font tout le contraire, comme le montrent les prises de position adoptées par les chefs d’entreprise lors des crises sanitaires des dernières décennies. En qualité d’épidémiologiste et d’ancien directeur adjoint d’une agence gouvernementale de santé publique sous la présidence de Barack Obama (Occupational Safety and Health, OSHA), j’ai été aux premières loges pour observer leur comportement. Instinctivement, les responsables font les mauvais choix : ils réfutent les allégations, défendent mordicus le produit en cause et cherchent à discréditer les faits scientifiques avérés qui appuient les inquiétudes du public. Bien évidemment, ni les chefs d’entreprises, ni les chantres de la déréglementation n’avoueront jamais qu’à leurs yeux, les profits sont bien plus importants que la santé de leurs employés et la sécurité de la population. De même, ils ne vont pas crier sur tous les toits que la qualité de l’air et de l’eau ne les préoccupe pas outre mesure : elle est d’abord l’affaire des écologistes. Mais leurs agissements sont parlants.
Aujourd’hui, les managers ont pour responsabilité première d’assurer la rentabilité à court et à long terme de l’entreprise qu’ils dirigent. Ils visent le profit et la croissance à tout prix. Perdre de l’argent est même si tabou que bon nombre d’entre eux en font un alibi pour justifier de cruelles décisions. Reste que faire des choix au plus haut niveau n’est jamais simple. Rien n’est tout blanc ou tout noir. Ils doivent tenir compte dans leurs calculs de divers facteurs comme les coûts d’une possible réglementation, une éventuelle perte de part de marché face à des produits moins nocifs ; et ils redoutent les actions en justice intentées par des victimes de leurs produits. On sait à quel point les procès coûtent cher, financièrement et en termes d’image.
Hélas, il n’y a là rien de nouveau : tout le monde sait – en particulier aux Etats-Unis – que les entreprises se sont lancées à corps perdu dans une course aux profits. Mais personne ne s’attendait à ce que des scientifiques se transforment en mercenaires. La science a une réputation d’objectivité et de sérieux. Elle se doit d’être apolitique, au-dessus de la mêlée. Cette manière sensée de voir les choses ne tient pas compte de la montée en puissance de scientifiques qui se vendent à des cabinets spécialisés dits de « défense de produits ». Ces cabinets de conseil emploient une kyrielle de pseudo-experts, de lobbyistes et de consultants en relations publiques qui détournent l’esprit et la méthode de la science dans le but de produire les résultats voulus par les entreprises qui les mandatent.
Cette activité en plein boom est pratiquée par une poignée de cabinets de référence. L’un d’entre eux – Exponent – est intervenu lors de l’affaire dite du « Deflategate », le scandale des ballons sous-gonflés qui a agité la National Football League (NFL) américaine. L’exemple est un peu futile, mais parlant. Tom Brady, le quaterback de l’équipe des New England Patriots a été soupçonné d’avoir fait dégonfler les ballons de son équipe lors d’un match décisif joué en janvier 2015. Lors des investigations, le patron de la NFL, Roger Goodell, a engagé un avocat qui a embauché à son tour la firme Exponent, l’un des cabinets de conseil les plus connus aux Etats-Unis.
Ces cabinets spécialisés dans la défense de produits emploient ou engagent au pied levé des scientifiques bien formés, des « experts » à l’aise avec les médias : toxicologues, épidémiologistes, biostatisticiens, spécialistes de l’évaluation des risques et autres professionnels (comme des économistes habiles à gonfler les coûts et à minimiser les avantages des réglementations proposées, et fins connaisseurs des questions de concurrence). Ils sont essentiellement chargés de produire du matériel scientifique montrant que le produit qui a été fabriqué, utilisé ou rejeté dans l’eau et l’atmosphère par l’entreprise est en fait moins dangereux qu’il n’y paraît. Ces « experts » produisent des rapports a priori impressionnants et publient leurs travaux dans des revues scientifiques à comité de lecture, où les articles sont relus… par des pairs des auteurs mercenaires. En d’autres termes, les cabinets de conseil sont à la manœuvre. Et si la tactique échoue, s’ils ne parviennent pas au résultat voulu par l’entreprise dont l’activité risque d’être entravée, ils relancent la machine à désinformer.
J’ai appelé cette stratégie « la fabrique du doute ». Son objectif est de semer la confusion dans l’esprit du public et des responsables gouvernementaux. Partout, les conclusions qui pourraient étayer de nouvelles réglementations sont systématiquement attaquées : les études animales sont jugées « non pertinentes », les données humaines « pas assez représentatives », les chiffres d’exposition sont discrédités et qualifiés de « non fiables », les faits ne sont jamais assez solides, les preuves d’effets nocifs toujours insuffisantes, et les effets négatifs sont jugés « de faible importance ».
Le scénario est toujours le même : le cabinet de conseil monte une opération de communication tout en la dissimulant sous un vernis scientifique. Les consultants en relations publiques des entreprises industrielles fournissent aux « experts » des éléments de langage et contre-argumentaires nécessaires pour discréditer les études scientifiques rigoureuses indiquant que le produit en cause est nocif. Convaincus qu’il y a toujours plusieurs manières de voir les choses et qu’elles sont toutes dignes d’intérêt, les grands médias se saisissent alors de ce qu’ils croient être un vrai débat scientifique, alors qu’il ne s’agit que d’une fausse controverse montée de toutes pièces. Les scientifiques à la solde des entreprises sont déployés auprès des agences de réglementation afin de peser sur leurs décisions. Ils interviennent aussi en cas de procès. Sciemment, les industriels et leurs complices manipulent le langage : ils se vantent de faire de la « bonne » science, alors même que leur travail est profondément biaisé. La science poubelle est portée aux nues, tandis que la recherche académique sérieuse – qui pourrait porter préjudice aux intérêts des industriels – est vilipendée.
Cela fait des décennies que des entreprises et des secteurs industriels entiers peaufinent cette stratégie, réclamant avec mauvaise foi toujours plus de preuves au lieu de prendre des précautions et d’agir pour le bien commun. De leur point de vue, entretenir une fausse polémique scientifique est ce qu’il y a de mieux pour repousser une réglementation contraignante à propos d’un produit dangereux pour l’homme et l’environnement. S’enfermer dans de faux débats, maintenir le doute est bien plus simple et plus efficace que de débattre des vraies questions. Des ouvrages très documentés comme Les Marchands du doute de Naomi Oreskes et Erik Conway (traduit de l’américain par Jacques Treiner, Ed. Le Pommier, 2012) ou mon propre ouvrage Doubt is Their Product : How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health (2008, non traduit) expliquent en détail les stratégies et tactiques employées par la grande industrie lors des nombreux scandales sanitaires et environnementaux qui ont jalonné ces cinquante dernières années : méfaits du tabac, tabagisme passif, amiante, pollution industrielle, produits chimiques nombreux et variés et autres substances nocives. Aujourd’hui encore, des industriels nient contre toute évidence les dangers et engagent « des scientifiques amis » pour dissimuler ou manipuler les faits. Pire : ces pratiques touchent désormais des domaines qui ne relèvent ni de la santé, ni de l’environnement : l’information peut se révéler toxique, au même titre que les produits. Les agissements de Facebook en sont la preuve.
Pour autant, les études faites sous la houlette des cabinets de conseil ne sont pas forcément erronées. Et il est légitime qu’un scientifique passe d’une hypothèse à une autre. Souvent, la science progresse vers la vérité en contestant ou en réfutant des vérités que l’on supposait éternelles. Il y a effectivement plusieurs manières de voir les choses. Mais toutes ne sont pas justes. En revanche, ce qui est sûr, c’est que la vérité scientifique ne se trouve pas dans les études commanditées par les cabinets de conseil dont l’existence dépend de leur capacité à produire les résultats voulus par les firmes industrielles.
Créer de l’incertitude est un outil de relations publiques très efficace. Le récent débat sur l’utilisation de preuves scientifiques dans la prise de décision publique en témoigne. Mais à la longue, les campagnes de défense des produits tiennent rarement la route. Certaines suscitent même très vite l’hilarité. Qu’importe ! Leur raison d’être a toujours été de semer la confusion pour gagner du temps – parfois beaucoup de temps – afin que la grande industrie continue d’engranger des profits et que des industriels préservent leur marché, le temps de développer de nouveaux produits. Reste que monter en épingle les incertitudes inhérentes à la science peut bloquer ou retarder des politiques de protection de la santé et de l’environnement. Et que susciter un doute raisonnable peut convaincre quelques jurés que la science n’est pas assez solide pour établir un lien entre une substance et une terrible maladie.
Avec le temps, au fur et à mesure que les études scientifiques rigoureuses gagnent en force de frappe et que celles qui ont été produites pour servir les intérêts de l’industrie s’avèrent douteuses ou fausses (voire tombent dans l’oubli sans que leurs auteurs ne soient jamais inquiétés pour leurs tactiques dilatoires), les décideurs à la tête des grands groupes finissent par jeter l’éponge. Ils admettent que leur produit a causé du tort. Ils se soumettent alors à une réglementation qui leur coûte parfois plus cher que ce qu’ils auraient dû payer à l’origine. Cela dit, ils savent compter : entretemps, le produit litigieux leur a rapporté beaucoup d’argent et leur fortune a pris l’ascenseur. Mais qu’en est-il des personnes touchées dans leur santé (ou pire) à cause des substances nocives ? Et qu’en est-il de l’environnement ? C’est tant pis pour eux !
Quant aux cabinets spécialisés dans la défense de produits, ils continuent de prospérer, saisissant toutes les occasions de manipuler les failles du système, à la croisée de l’argent et de la science. Dans le cas du « Deflategate », le rapport officiel d’Exponent a permis aux avocats de la NFL d’affirmer, quatre mois après le match, que les experts « n’avaient pas trouvé de facteurs physiques ou environnementaux crédibles » permettant d’expliquer complètement l’altération de la pression à l’intérieur des ballons des New England Patriots. Compte tenu d’autres preuves circonstancielles, ils en ont conclu « qu’il était plus probable qu’improbable » que les ballons ont été dégonflés intentionnellement. Pour être honnête, la NFL s’est également appuyée sur des messages écrits et d’autres éléments suggérant que les ballons ont bel et bien pu être dégonflés. Quoi qu’il en soit, le cabinet de conseil Exponent a fait ce qu’on attendait de lui : il a apporté à la NFL la conclusion voulue qui a permis de monter l’accusation contre le quaterback Tom Brady.
Cela dit, le rapport qu’Exponent a remis aux propriétaires des New England Patriots a fini par embarrasser la NFL. John Leonard, spécialiste en robotique et professeur en génie mécanique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) a été l’un des premiers à remettre en question le travail de la firme Exponent. Il a analysé les résultats et démontré que les calculs faits à l’origine étaient incorrects et « qu’aucun dégonflement répréhensible n’avaient été effectué ». Sa conférence fascinante à ce propos, diffusée sur YouTube, a été vue plus de 500 000 fois. Comme il vit et travaille dans l’Etat du Massachusetts, certains auraient pu l’accuser de partialité. Pas de chance : John Leonard est un fervent supporter des Philadelphia Eagles ! De plus, d’autres sommités ont critiqué le rapport d’Exponent : plusieurs professeurs de l’université Carnegie Mellon de Pittsburgh, de l’université de Chicago, de l’université Rockfeller ou d’autres établissements ont signalé des erreurs. Décidément, cette intervention dans le « Deflategate » n’est pas à l’honneur des cabinets de conseil…
Il n’est pas faux de dire que la méthodologie utilisée dans la défense de produits est inversée. Le « chercheur » payé par le cabinet de conseil détient dès le départ la réponse. Elle lui est souvent fournie par une tierce personne. A lui de trouver ensuite la meilleure manière d’y parvenir ! Il peut se lancer dans une revue de la littérature ou soumettre l’étude qu’il doit combattre à une « réanalyse post-hoc ». Celle-ci aboutit alors, comme par magie, à la conclusion souhaitée par l’industriel : « non, le risque n’est pas aussi élevé que cela », ou « non, l’effet nocif n’est pas aussi sérieux que cela », ou « les données brutes utilisées dans l’étude d’origine ne sont pas pertinentes (ou les trois à la fois). Ce sont ces « études », représentatives d’une science poubelle, qui prennent le chemin des agences de régulation et des tribunaux.
Dans l’environnement politique toxique d’aujourd’hui, il est utile de savoir décrypter les méthodes des grandes entreprises qui orientent les discours politiques. Ce qui suit est un manuel de désinformation. Il montre comment les industriels font main basse sur la science en détournant ses méthodes et en brouillant sa perception pour retarder ou stopper les prises de décision.
Le poids de la preuve
L’une des tactiques les plus populaires – peut-être la plus populaire – est dérivée de ce qu’on appelle « la revue de la littérature ». A la base, cette approche a toute sa raison d’être. Nous, les scientifiques, nous avons vraiment besoin de nous appuyer sur les études faites jusqu’ici pour tenter de cerner des problématiques importantes. Les questions soulevées lors d’un procès ou dans le cadre d’une réglementation sont toujours complexes. Elles vont au-delà des interrogations classiques comme : « Est-ce que ce produit chimique cause le cancer, abaisse la fertilité ou impacte le développement de l’enfant ? » En santé publique, le plus important – et le plus difficile – est de déterminer le rapport entre la dose (l’exposition à une substance donnée) et la réponse : il s’agit de trouver quel niveau d’exposition peut produire un effet négatif sur la santé, après quel laps de temps, à quelle fréquence. Il s’agit aussi d’établir le seuil toxique, c’est-à-dire la quantité minimale sous laquelle la substance incriminée ne produit aucun effet délétère (ou n’a pas produit d’effet délétère, dans le cas d’un procès). Impossible de répondre à toutes ces questions par le biais d’une seule étude ! La revue de la littérature implique toujours l’analyse critique de plusieurs documents.
Parfois, ces revues de la littérature sont dites « analyses du poids de la preuve ». Les auteurs décident alors eux-mêmes de l’importance à accorder à chaque étude. Cela dit, si votre modèle d’affaire et la viabilité de votre cabinet de conseil dépendent de l’argent que le fabriquant du produit incriminé vous verse pour ces analyses, alors votre jugement est par définition suspect. Par conséquent, si une revue de la littérature est faite par des scientifiques désireux d’aboutir aux conclusions dont l’industriel a besoin pour repousser une réglementation ou gagner un procès, elle devrait être considérée comme biaisée et écartée avec la plus grande fermeté. Comment savoir en effet si la pondération des études a été impactée, consciemment ou non, par le résultat attendu par celui qui a mis l’argent sur la table ?
L’évaluation des risques
En général, les analyses du poids de la preuve intègrent des études animales et des études sur des humains. La pondération de chaque étude relève le plus souvent d’une décision subjective, qualitative. Une approche plus quantitative implique ce qu’on appelle « l’évaluation du risque ». Dans sa forme la plus sérieuse, il s’agit d’estimer la probabilité d’apparition d’effets négatifs selon divers niveaux d’exposition. A cela s’ajoute l’évaluation du seuil sous lequel l’exposition à la substance ne présente aucun danger. Mais il faut rester prudent : n’oublions pas la célèbre boutade de William Ruckelshaus, premier directeur de l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA) : « L’évaluation du risque est comme l’espion que vous avez arrêté : si vous le torturez assez longtemps, il vous donnera pratiquement tout ce que vous voulez. »
C’est vrai, les conclusions des études d’évaluation des risques peuvent diverger fortement. Certains scientifiques et certaines firmes ont aussi la réputation de produire des études aboutissant systématiquement à des seuils d’apparition d’un risque significatif qui sont bien supérieurs aux niveaux où la plupart des expositions se produisent. Du pain béni pour les industriels qui ont sponsorisé ces études ! En effet, si les jurés et les agences de réglementation acceptent l’évaluation, les travaux de dépollution et les dédommagements aux victimes leur coûteront bien moins cher.
La réanalyse des données
Pour créer le doute, les cabinets spécialisés en défense de produits ont trouvé une cible facile : l’épidémiologie. Dans ce domaine, les études sont complexes et impliquent des analyses statistiques poussées. A chaque étape, l’épidémiologiste doit faire preuve de jugement et de probité. Les bonnes pratiques de l’épidémiologie et la déontologie exigent que les procédures d’analyse soient sélectionnées avant que les données ne soient analysées. L’une des tactiques utilisées par certains cabinets de conseil est ce qu’on appelle « la réanalyse » : les données brutes d’une étude déjà achevée sont évaluées à nouveau, ce qui modifie l’analyse des données, le plus souvent dans le sens des intérêts de l’industriel. Comme le veut la blague : « Il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. »
La bataille pour l’intégrité de la science s’enracine dans ces questions de méthodologie. Si un scientifique un tant soit peu habile connaît les conclusions et l’organisation des données au sein de l’étude, il n’aura aucun mal à construire une étude alternative qui fera disparaître purement et simplement le résultat positif. Le risque de manipulation est d’autant plus grand que l’étude évoque un lien entre une substance donnée et une maladie apparaissant bien des années plus tard. Or cette information est celle qui intéresse au premier chef les agences gouvernementales de protection de la santé. En revanche, si l’exposition à une substance n’a aucun effet, il semble difficile, voire impossible, de faire une analyse post-hoc pour transformer le résultat négatif en résultat positif, l’effet recherché étant également réparti au sein de la population sous revue.
Comme toutes les tactiques utilisées dans la défense des produits, la réanalyse des données a été développée à l’origine par les cigarettiers. Il leur fallait contrer les premiers résultats scientifiques sur la dangerosité du tabac, et en particulier du tabagisme passif. L’urgence était double : il s’agissait d’atténuer leur responsabilité et de repousser – voire de bloquer – la réglementation qui se profilait, et dont l’objectif était de protéger les femmes non-fumeuses partageant la vie d’un fumeur. Du point de vue de la santé publique, si le risque de développer un cancer augmente de 25%, la situation est alarmante. Il était donc crucial que l’industrie du tabac fasse disparaître au plus vite cette information. Les cigarettiers se sont alors tournés vers la réanalyse des données : leurs stratèges avaient compris que faire leurs propres études allait prendre trop de temps et coûter trop cher. Ils ont donc estimé qu’il valait mieux se procurer les données brutes des études incriminantes, changer quelques hypothèses de base, adopter d’autres paramètres, traficoter ceci ou cela, pour faire disparaître le résultat gênant. L’approche des cigarettiers est restée monnaie courante : la réanalyse des données fait partie de la « production maison » de tous les cabinets de défense des produits.
La simulation rétrospective
Quand un risque élevé de maladie est associé à un faible niveau d’exposition à un produit chimique donné, les scientifiques qui réanalysent les études épidémiologiques pour les cabinets de conseil décrètent souvent que les valeurs d’exposition étaient en fait nettement plus élevées que celles qui ont été utilisées dans l’étude d’origine. C’est ridicule bien sûr, mais très utile. Car cet ajustement rétrospectif des données d’exposition change la donne : d’un coup, l’exposition semble moins inquiétante parce que désormais, seuls ces niveaux d’exposition plus élevés peuvent causer la maladie. Ces scientifiques agissent en toute connaissance de cause : ils savent pertinemment ce qui arrive quand on gonfle les valeurs d’exposition d’origine.
Mais si le lien entre le niveau d’exposition à une substance donnée et la survenue d’une maladie est avéré, l’entreprise qui a fabriqué le produit litigieux peut souhaiter démontrer que les valeurs d’exposition historiques étaient en fait inférieures, pas supérieures. Pour ce faire, les scientifiques qu’elle a engagés doivent essayer de recréer en laboratoire les niveaux d’exposition historiques. Cette méthode est généralement réservée aux cas litigieux qui font l’objet d’un procès où l’industriel a beaucoup à perdre. Revisiter la science établie en fonction de niveaux d’exposition anciens n’a en effet aucun intérêt scientifique. La démarche peut réserver des surprises. Il faut parfois faire un vrai travail de détective pour retrouver le produit original. Souvent, il n’est plus ni fabriqué, ni utilisé. Ensuite, il faut simuler le degré d’exposition que le plaignant aurait subi il y a des décennies. De telles études rétrospectives sont parfois publiées dans les revues scientifiques. Pas par intérêt scientifique, mais pour que « l’expert » qui a réalisé cette étude puisse affirmer lors du procès qu’elle a été évaluée par des pairs. C’est une forme de caution.
La fiction de l’indépendance
De nombreuses études diligentées par les cabinets spécialisés dans la défense de produits intègrent une drôle de petite note. Elle stipule que même si les scientifiques impliqués dans l’étude peuvent être amenés à témoigner en faveur des entreprises poursuivies en justice, la recherche en tant que telle a été effectuée « en toute indépendance ». Ce tour de passe-passe crée une fiction autour de l’indépendance de l’étude, et donne une fausse impression d’objectivité. En fait, ces études sont presque toujours financées par les cabinets de défense de produits qui utilisent pour ce faire une partie des émoluments versés par l’industriel. C’est une mascarade. Et, hélas, une pratique courante.
Les organismes-écrans
D’autres conflits d’intérêt, d’autres tromperies et falsifications sont le fait d’associations-écrans. Elles permettent à de nombreux industriels d’avancer leurs pions tout en dissimulant leur implication. Il s’agit souvent de structures à but non lucratif, ayant parfois des visées éducatives, dirigées par des scientifiques. Elles portent généralement des noms anodins, alors même que ces associations sont loin d’être neutres : elles appartiennent aux diverses entreprises qui les financent. Bon nombre d’entre elles sponsorisent la « recherche » utilisée lors de procès et de procédures règlementaires. Quant aux « think tanks », ces laboratoires d’idées qui se consacrent aux grandes causes comme « la libre entreprise », « le marché libre » ou « la déréglementation », ils sont nombreux à travailler pour les grands groupes industriels. Chaque année, ils collectent des millions de dollars auprès des firmes réglementées pour financer des campagnes de communication qui fragilisent la santé publique et la protection de l’environnement.
L’idée de base est toujours la même. Il s’agit de présenter favorablement ces organismes-écrans, de mettre en avant leur sérieux et d’affirmer qu’ils font des études scientifiques indépendantes. Certains font effectivement de la vraie science. Ce qui ne les empêche pas de produire en parallèle de la pseudo-science qui permet à ceux qui les financent de promouvoir des produits malsains. Un exercice d’équilibrisme délicat…
Ces méthodes menacent sérieusement les progrès réalisés ces dernières décennies pour protéger la science qui étaye la politique de santé et la protection de l’environnement. La campagne que les cigarettiers ont mené dans les années 50 pour semer le doute sur la nocivité du tabac est la matrice de la politique des industriels en 2020. Pour démêler le bon grain de l’ivraie, il faut suivre la piste de l’argent. Aujourd’hui, de grandes entreprises et des individus fortunés subventionnent en sous-main quantité d’organismes à but non lucratif. Leur objectif ? Propager auprès du public un discours pseudo-scientifique qui fait douter du changement climatique, de la nocivité de certaines substances, ou des effets néfastes sur la santé des sodas et de l’alcool. Il n’est pas facile de trouver les noms des bailleurs de fonds. C’est un monde plein de secrets. Les rares informations qui ont filtré ont été divulguées à la suite d’un procès ou par accident.
La fabrique du doute a tout envahi, retardant des prises de décision, si bien que des substances dangereuses empoisonnent ce que nous mangeons, ce que nous buvons et l’air que nous respirons. Des milliers de personnes en souffrent. Il est certain que si ces campagnes n’avaient pas été menées, la population s’en porterait mieux et l’état de la planète serait moins préoccupant. Depuis l’élection de Donald Trump, l’« evidence based policy » – selon laquelle les politiques publiques doivent être basées sur des données probantes – est menacée comme jamais. Ainsi, des informations jugées inopportunes sont taxées de « fake news », d’intox, et les rapports scientifiques dérangeants de « fausse science ». Aussi incroyable que cela puisse paraître, le gouvernement fédéral américain donne la préférence aux études produites par des cabinets de conseil au détriment d’études académiques rigoureuses et indépendantes. Pire : des scientifiques ayant fait carrière dans la fabrication d’études sponsorisées qui « blanchissent » des produits toxiques sont nommés à des postes à responsabilité dans des agences gouvernementales chargées de réglementer ces mêmes substances.
Ces dérapages graves ne peuvent pas nous laisser indifférents. Il nous faut agir. La science et la démocratie sont à la croisée des chemins. Il est temps d’ouvrir les yeux. Il est temps de nous rendre compte que si la science peut nous aider à protéger notre santé et celle de la planète, son mésusage nous met clairement en danger.
A propos de l’auteur :
David Michaels est épidémiologiste, Professeur à l’Université George Washington, et l’auteur de l’ouvrage (non traduit) The Triumph of Doubt: Dark Money and the Science of Deception. Il a été Secrétaire-adjoint de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) sous la présidence de Barack Obama, de 2009 à 2017.